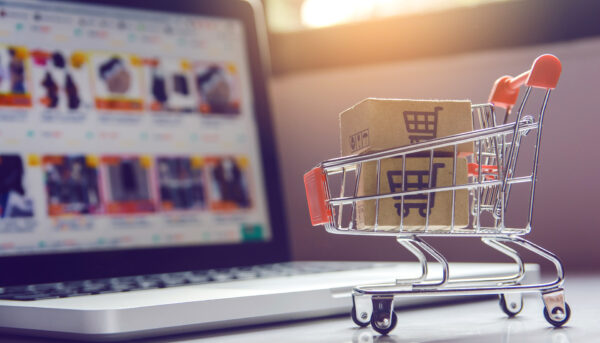L’imposition de droits de douane par les États-Unis pousse les Canadiens à « acheter canadien ». Si vous songez à mettre en évidence les origines canadiennes de vos produits en utilisant des mentions telles que « Fait au Canada » ou « Produit du Canada » ou des symboles représentatifs du Canada dans vos étiquettes et déclarations commerciales, tenez compte de l’information qui suit pour éviter les importants risques juridiques, financiers et réputationnels.
Le cadre juridique
Les indications d’origine canadienne sont régies par la Loi sur la concurrence, la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, la Loi sur l’étiquetage des textiles, la Loi sur les aliments et drogues ou la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (les « Lois »). Ces Lois veillent à ce que les entreprises s’abstiennent de faire des indications fausses ou trompeuses concernant l’origine des biens de consommation et des produits alimentaires.
Représenter les biens de consommation canadiens
Le Bureau de la concurrence a publié des lignes directrices visant à faciliter l’interprétation des Lois en ce qui concerne les biens de consommation (les « lignes directrices »)[1]. Le Bureau de la concurrence fait une distinction entre les indications « Produit du Canada » et « Fait au Canada » selon le pourcentage de contenu canadien. Dans les deux cas, il faut que la dernière transformation substantielle du produit ait été effectuée au Canada.
Pour qu’un produit soit considéré comme un « produit du Canada », 98 % des coûts directs de production ou de fabrication du produit doivent avoir été engagés au Canada. Par comparaison, pour utiliser l’indication « Fait au Canada », 51 % seulement des coûts directs de production ou de fabrication du produit doivent avoir été engagés au Canada. L’indication « Fait au Canada » doit en outre être accompagnée d’un énoncé descriptif indiquant la présence de contenu importé (p. ex., « Fait au Canada avec des composants canadiens et importés » ou « Fait au Canada avec des composants importés »).
Si aucune de ces indications ne s’applique, mais que votre produit comporte tout de même une certaine part de contenu canadien, le Bureau de la concurrence recommande d’utiliser un terme plus précis qui reflète l’activité réalisée au Canada, comme « Assemblé au Canada ꟷ composants importés ».
Représenter les produits alimentaires canadiens
La Loi sur les aliments et drogues et la Loi sur la salubrité des aliments au Canada interdisent les indications fausses et trompeuses concernant les produits alimentaires. Les indications « Fait au Canada » concernant les produits alimentaires peuvent être vérifiées par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (« ACIA »)[2] et le Bureau de la concurrence en vertu de ses lignes directrices susmentionnées. À l’instar des biens de consommation, les produits alimentaires portant la mention « Fait au Canada » doivent avoir subi leur dernière transformation substantielle au Canada (par exemple, transformer la pâte, le fromage et la sauce tomate en une pizza) et être accompagnés d’un énoncé indiquant si le produit est fabriqué à partir d’ingrédients importés ou d’une combinaison d’ingrédients importés et d’ingrédients canadiens.
Un produit alimentaire peut porter l’indication « Produit du Canada » ou « Canadien » si la totalité ou la quasi-totalité de ses principaux ingrédients, du processus de transformation et de la main-d’œuvre sont d’origine canadienne. La proportion du contenu étranger du produit alimentaire doit être négligeable (p. ex., les ingrédients présents en très petites quantités, comme les épices ou les additifs alimentaires, qui constituent moins de 2 % du produit peuvent être importés). En raison de ces exigences strictes, les produits qui sont exportés puis importés de nouveau au Canada ne peuvent généralement pas porter l’indication « Produit du Canada ». Pour porter la mention « Produit du Canada », certains types d’aliments, tels que la viande et la volaille, le poisson et les fruits de mer, les produits laitiers et les œufs, sont soumis à des exigences plus précises.
Utilisation de symboles représentatifs du Canada
L’utilisation du drapeau canadien ou de la feuille d’érable sur un produit peut laisser entendre qu’il s’agit d’un « Produit du Canada » ou d’un produit « Fait au Canada ». Pour éviter d’induire les consommateurs en erreur, le symbole doit être accompagné d’un énoncé sur le contenu canadien. Par ailleurs, pour utiliser le drapeau national du Canada et la feuille d’érable officielle stylisée à 11 pointes, il faut obtenir l’autorisation du ministère du Patrimoine canadien[3].
Directives des Normes de la publicité – Critère de l’impression générale
Récemment, les Normes de la publicité du Canada (les « Normes de la publicité »), un organisme d’autoréglementation de la publicité, ont publié un avis sur les allégations de type « Fait au Canada » en vertu du Code canadien des normes de la publicité[4]. En plus des directives susmentionnées, les Normes de la publicité ont souligné leurs récentes décisions concernant les allégations de produits canadiens. Dans l’ensemble, le Conseil des Normes de la publicité a souligné l’importance d’une publicité claire et précise. Lors de l’évaluation de la véracité et de l’exactitude d’un message, on tiendra plutôt compte de l’impression générale qui se dégage de la publicité. Par exemple, dans un cas, les allégations « Fièrement fait au Canada » affichées à la page d’accueil du site Web d’une entreprise ont été jugées trompeuses, car le site Web n’indiquait pas de façon suffisamment claire aux consommateurs que l’allégation d’origine canadienne s’appliquait uniquement à certains produits énumérés sur le site Web. De même, la publicité d’une entreprise étrangère affirmant qu’elle était « véritablement canadienne » a été jugée trompeuse, malgré le fait que l’entreprise avait déjà été détenue par des Canadiens et qu’elle occupait une position de leader au Canada.
Soulignons également la nécessité de prendre en considération la manière dont un énoncé descriptif est fait pour une allégation « Fait au Canada ». Bien que l’utilisation d’avertissements et d’astérisques soit généralement autorisée par les lois canadiennes sur la publicité et le marketing, ce type de mentions restrictives ne doit servir qu’à ajouter de l’information utile, à développer un élément d’information ou à clarifier les ambiguïtés potentielles d’un énoncé qui est déjà véridique et exact dans l’énoncé principal. Toute information supplémentaire fournie par une mention restrictive ne doit pas avoir pour but de restreindre, de contredire ou d’annuler de quelque façon que ce soit le message principal auquel il se rapporte. De plus, ces mentions restrictives doivent être formulées clairement et lisiblement, et être placées à un endroit qui ne risque pas d’échapper au consommateur.
Application de la loi et litiges entre concurrents
Étant donné le climat économique et politique qui règne actuellement, nous constatons également que les entreprises portent une attention accrue aux allégations de type « Fait au Canada » faites par leurs concurrents. Dans certains cas, les entreprises peuvent choisir de déposer une plainte auprès du Bureau de concurrence. Elles peuvent également recourir à la procédure de règlement des litiges entre concurrents des Normes de la publicité du Canada. Cette procédure de règlement des litiges prend la forme d’un panel d’experts en droit de la publicité chargés d’examiner ces allégations afin d’en déterminer la validité. En règle générale, cet examen n’a lieu que si les efforts déployés pour régler le litige directement avec le concurrent sont restés vains. Mentionnons que les parties au litige ne sont pas autorisées à divulguer publiquement la décision définitive ni à en discuter publiquement (sauf au sein de leurs organisations respectives). Cette procédure ne vise pas à punir l’annonceur; généralement, elle donne plutôt lieu à la suppression ou à la modification de la publicité inappropriée.
Une enquête du Bureau de la concurrence concluant à des allégations fausses et trompeuses à l’égard de biens de consommation peut également donner lieu à de lourdes sanctions en vertu de la Loi sur la concurrence. Ces sanctions peuvent comprendre : une ordonnance de cesser le comportement, la publication d’avis de correction et, dans le cas des personnes morales, des sanctions administratives pécuniaires pouvant atteindre 10 millions de dollars ou correspondant à trois fois la valeur du bénéfice tiré du comportement ou, si ce montant ne peut être déterminé, à trois pour cent des recettes globales brutes de la personne morale.
Conclusion
Si la promotion de l’origine canadienne de vos produits peut être une technique de marketing efficace en cette période marquée par le patriotisme des consommateurs, il est important de connaître les règles et les règlements en vigueur afin d’éviter les sanctions et de préserver la confiance des consommateurs.
Si vous avez des questions à propos des indications de produits, y compris les indications d’origine canadienne, n’hésitez pas à communiquer avec un membre du groupe Marketing, publicité et conformité des produits de Miller Thomson.
[1] Lignes directrices, Les indications « Produit du Canada » et « Fait au Canada », Bureau de la concurrence, 22 décembre 2009,
[2] Les allégations concernant l’origine sur les étiquettes des aliments, Agence canadienne d’inspection des aliments, 6 décembre 2023,
[3] Ibid.
[4] Avis sur la signification de « Fait au Canada » et autres allégations semblables en vertu du Code canadien des normes de la publicité, Normes de la publicité,