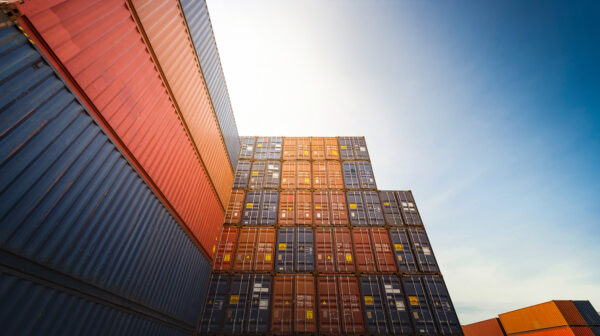Une fois de plus, les règles du jeu en matière de commerce ont changé. Tandis que l’administration américaine intensifie ses politiques tarifaires, les entreprises canadiennes se retrouvent confrontées à des défis qui vont au-delà de la seule augmentation des droits de douane C’est en effet toute la mécanique du commerce transfrontalier qui subit une transformation en profondeur, que ce soit sur le plan de la fiscalité, de la réglementation ou du respect des lois. Pour les entreprises manufacturières ou exportatrices présentes sur le marché nord-américain, il s’agit d’enjeux stratégiques majeurs.
À la suite des réflexions soulevées lors de la conférence « Navigating Tariffs: A Canadian Global Perspective » que Miller Thomson a tenue à Vancouver, des experts en droit, fiscalité et commerce, notamment le conférencier Gordon McGuinty, directeur, Prix de transfert de PwC, ont partagé leur point de vue sur la compréhension des enjeux tarifaires actuels et la préparation pour relever les défis à venir.
Examinons les changements récents et les leviers dont dispose votre entreprise maintenant.
Comprendre l’évolution des politiques américaines en matière de commerce international
Pour lancer ses offensives tarifaires, l’administration Trump a remis à l’ordre du jour sa politique commerciale « America First », évoquant des lois américaines de longue date, notamment l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) – la loi qui encadre les sanctions économiques en situation d’urgence internationale –, l’article 232 du Trade Expansion Act (sécurité nationale) et l’article 301 du Trade Act of 1974 (pratiques commerciales déloyales). Aujourd’hui, les droits de douane sur les marchandises provenant de l’ensemble de ses partenaires commerciaux, qu’il s’agisse d’entreprises alliées ou adversaires, se situent entre 10 % et 50 %.
Un air de déjà-vu? C’est normal, mais les règles ont évolué. L’un des principaux changements est la fin de l’exemption de minimis de 800 $ US, grâce à laquelle les envois de faible valeur pouvaient jusqu’alors franchir la frontière américaine sans imposition de droits de douane. Ciblant d’abord la Chine et Hong Kong, ce revirement est le signe de l’attention grandissante accordée au commerce en ligne et aux biens de consommation.
Pour ajouter à la complexité de la situation, de nombreuses entreprises manufacturières au Canada étaient convaincues que leurs produits répondaient aux exigences de l’ACEUM (ancien ALENA), mais ont omis de se procurer une certification en bonne et due forme pour valider leur conformité. Dans le contexte actuel d’application des lois et des règlements, cette erreur est coûteuse.
De plus, le département américain de la Justice s’est expressément engagé à utiliser le False Claims Act (la loi sur les allégations fallacieuses) pour engager des poursuites en cas de non-respect de la réglementation douanière. Des lanceurs d’alerte, y compris les entreprises concurrentes, peuvent signaler tout classement erroné ou toute fausse déclaration, exposant ainsi les entreprises à des amendes, à des vérifications douanières ou à des poursuites. Cette loi incite notamment à la dénonciation : elle permet aux citoyens d’intenter des poursuites de type qui tam contre les présumés fraudeurs du gouvernement américain, avec la possibilité pour eux de percevoir une part des sommes récupérées s’ils obtiennent gain de cause.
Remise en question du pouvoir présidentiel
Des plaintes concernant les droits de douane ont été déposées auprès du Tribunal de commerce international des États-Unis (le « Tribunal ») par un mouvement apolitique, le Liberty Justice Center, au nom de petites entreprises américaines et de plusieurs États, notamment l’Oregon, l’Arizona et l’État de New York. Le 28 mai 2025, le Tribunal a statué à l’unanimité que l’utilisation, par le président, de l’IEEPA pour justifier les mesures tarifaires mondiales annoncées le 2 avril dernier (désigné le « jour de la Libération ») et les droits de douane spécifiques sur les biens importés en provenance du Mexique, du Canada et de la Chine, contrevenait à la législation en vigueur. Le Tribunal ne s’est pas prononcé sur la question de savoir si les droits de douane perçus à ce jour en vertu de l’IEEPA devaient être remboursés aux importateurs, mais il a ordonné au président des États-Unis de prendre des mesures pour les supprimer. Au lieu de cela, ce dernier a pris des mesures pour faire appel de cette décision. La Cour d’appel du circuit fédéral des États-Unis (la U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit) (la « CAFC ») a temporairement suspendu l’ordonnance, le temps d’examiner les requêtes soumises. À l’heure actuelle, le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (le U.S. Customs and Border Protection) continue de percevoir les droits de douane en vertu de l’IEEPA. À moins que la CAFC et la Cour suprême des États-Unis n’acceptent d’accélérer la procédure d’appel, une longue période d’incertitude attend les entreprises manufacturières et les exportateurs du Canada, ainsi que leurs clients aux États-Unis.
Réponse du gouvernement du Canada et messages à l’intention des entreprises
Le gouvernement du Canada n’est pas resté les bras croisés. Il a réagi en mettant en place une stratégie de contre-mesures ciblées, notamment une liste de surtaxes de l’ordre de 60 milliards de dollars visant des États et des secteurs américains politiquement sensibles, mais c’est sur le territoire national que les effets se sont véritablement fait sentir.
Le décret d’avril 2025 accorde une remise globale de la surtaxe de rétorsion pour les biens d’origine américaine importés au Canada par ou pour le compte d’institutions publiques responsables de la santé publique, de la sécurité publique et de la sécurité nationale. L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a depuis publié un Avis des douanes définissant l’étendue de la remise accordée et précisant que l’ASFC interprète le décret de manière restrictive, afin d’exclure tout bien non utilisé à des fins de santé publique, de sécurité publique et de sécurité nationale. Le décret prévoit également une remise pour tous les biens d’origine américaine importés au Canada à des fins d’utilisation dans la fabrication, la transformation au Canada (dans n’importe quel secteur de fabrication) ou l’emballage d’un produit alimentaire ou d’une boisson au Canada. De plus, l’Avis des douanes de l’ASFC confirme que la remise s’applique autant aux produits finaux de la fabrication, de la transformation ou de l’emballage destinés à la consommation au Canada qu’aux produits destinés à l’exportation.
Si votre entreprise n’appartient pas à l’une de ces catégories, elle peut tout de même prétendre à la remise destinée aux importateurs, à condition de démontrer l’existence de contraintes et de risques économiques.
Exemples concrets
- La remise a été accordée à une société d’importation d’aluminium qui a fait valoir qu’aucune source d’approvisionnement canadienne n’était disponible et que des mises à pied étaient à craindre.
- Des producteurs de fromage ayant recours à des intrants laitiers importés ont pu bénéficier de mesures d’exonération grâce au programme canadien des produits destinés à l’exportation.
Le classement tarifaire, un outil stratégique, mais risqué
Votre produit pourrait-il faire l’objet d’un classement dans une autre catégorie pour réduire les droits de douane? Peut-être, mais attention. Toute tentative de tirer avantage des « zones grises » du Système harmonisé sans avoir obtenu l’avis des autorités douanières peut entraîner des pénalités, voire une enquête pour fraude.
Capacité opérationnelle de la chaîne d’approvisionnement : du champ jusqu’à la porte
L’origine des produits n’a jamais été aussi importante La conformité au classement tarifaire exige une documentation précise sur le lieu et le mode de fabrication des produits. Savoir qui a assemblé le produit final ne suffit plus : il est maintenant essentiel de connaître la provenance de chaque matière première et intrant, c’est-à-dire l’endroit où l’acier a été coulé, l’endroit où les produits ont été cultivés et l’endroit d’où proviennent les composants.
Désormais, les entreprises avisées mettent en œuvre les mesures suivantes :
- Analyse des manques visant à faire une évaluation comparative des procédures en place par rapport aux attentes des autorités.
- Exploration des divers scénarios et modélisation de la sensibilité.
- Vérification des documents des fournisseurs afin de veiller à la conformité tout au long de la chaîne d’approvisionnement.
- Passage en revue de l’origine pour confirmer (ou reconfirmer) l’admissibilité aux dispositions de l’ACEUM.
De nombreuses entreprises constituent des équipes pluridisciplinaires au sein d’une cellule interne dédiée à la coordination des tâches suivantes :
- Renégociation des contrats
- Vérification des certifications en vertu de l’ACEUM
- Vérification des déclarations douanières
Programmes gouvernementaux d’exonération des droits et d’encouragement commercial
En complément des mécanismes de remboursement (drawback) et d’exonération des droits, le gouvernement met à la disposition des entreprises canadiennes une gamme de programmes d’encouragement commercial pour limiter leurs risques tarifaires et stimuler leur compétitivité à long terme. Par exemple, le Programme d’exonération des droits permet aux entreprises admissibles d’importer des marchandises sans avoir à payer de droits, à condition que ces marchandises soient par la suite exportées ou utilisées dans la fabrication de produits destinés à l’exportation.
Les autorités provinciales et fédérales ont également mis en œuvre des solutions de financement ciblées pour soutenir les efforts suivants :
- La diversification des chaînes d’approvisionnement
- Les investissements pour la relocalisation ou le rapprochement de la production
- La modernisation des procédés de fabrication
- La mise à niveau des systèmes automatisés visant à assurer la conformité relative au commerce
Pour bénéficier des appuis financiers, il est essentiel de maintenir une veille active sur ces programmes et de documenter les risques commerciaux auxquels l’entreprise est exposée. En plus d’atténuer les pressions douanières, ces programmes sont conçus pour aider les entreprises à structurer durablement leurs activités transfrontalières futures.
En complément, les entreprises canadiennes d’importation peuvent avoir accès à plusieurs programmes publics :
- Remise générale des droits de douane applicables à certains secteurs spécifiques
- Remise spécifique à des sociétés d’importation en cas de difficultés exceptionnelles
- Remboursement (drawback) des droits de douane lors de la réexportation des marchandises
Conseil : les entreprises qui prennent le temps de bien se préparer tireront un avantage concret de ces programmes. Assurez-vous de maintenir des dossiers détaillés et évaluez proactivement votre admissibilité à ces programmes.
Considérations fiscales et réglementaires
Ces mesures commerciales s’accompagnent d’enjeux fiscaux et de contraintes réglementaires, parfois directes, parfois indirectes. Les droits de douane font partie de la valeur imposable des biens importés, ce qui accroît le montant de TPS exigible. Les entreprises doivent réévaluer leurs cautionnements en douane et s’assurer de conserver leur « privilège de la mainlevée avant le paiement ». L’augmentation soudaine des droits de douane peut compromettre ces privilèges si le montant du cautionnement est insuffisant.
La planification tarifaire soulève plusieurs points à considérer en matière d’impôt sur le revenu, notamment :
- Si vous exercez vos activités par l’entremise d’une filiale américaine contrôlée, les revenus gagnés par la filiale seront attribués à l’actionnaire canadien en vertu du régime concernant le RÉATB au Canada et les actionnaires seront assujettis à des taux d’imposition élevés. En planifiant soigneusement, il est possible d’échapper à l’application de ces règles onéreuses et d’éviter toute charge fiscale supplémentaire.
- Les modifications apportées aux chaînes d’approvisionnement ou aux activités commerciales en réaction aux droits de douane peuvent avoir une incidence sur les taux d’imposition à l’échelle nationale et l’accès à certains avantages fiscaux. Les entreprises canadiennes ne doivent pas supposer que les avantages fiscaux en vigueur – tels que la réduction du taux d’imposition dans le cadre de la déduction accordée aux petites entreprises ou le statut des actions admissibles de petite entreprise – continueront de s’appliquer sans tenir compte de la façon dont les changements dans l’emplacement de l’entreprise, l’utilisation des actifs ou les sources de revenus peuvent affecter l’admissibilité.
- Le regroupement des redevances, des frais de transport ou des assurances dans la valeur déclarée des marchandises importées peut entraîner un paiement excessif. Il est recommandé de les répartir séparément au moyen de contrats distincts (p. ex., des conventions de licence et des garanties) et d’imposer des frais distincts. Dans certaines circonstances, il est recommandé que ces services et toute licence relative aux droits de propriété intellectuelle destinés au client américain soient assurés par une filiale canadienne distincte du vendeur canadien du produit.
- Dans toutes les opérations interentreprises, les prix de transfert déterminent les valeurs nécessaires à la validation des déclarations douanières. Lorsque des opérations impliquent à la fois une filiale américaine et un résident du Canada, les règles des prix de transfert applicables à l’impôt sur le revenu au Canada doivent être prises en compte attentivement.
Le « principe de première vente » aux États-Unis, une stratégie de planification souvent sous-employée, offre aux importateurs la possibilité de fonder les droits de douane sur le prix payé par le premier acheteur dans la chaîne d’approvisionnement, et non sur celui payé par le client final, à condition de respecter certains critères importants. Conjuguée à d’autres stratégies, l’application de cette règle peut entraîner une valorisation moins élevée des marchandises aux fins du calcul des droits de douane, mais il est important de consulter un expert, compte tenu de la complexité du calcul. L’insuffisance des documents, l’impossibilité de démontrer que la structure de la vente a été exécutée de bonne foi, ainsi que les questions liées à la fixation des prix entre parties liées peuvent entraîner la réévaluation des droits de douane et des pénalités.
Par ailleurs, toute majoration des droits de douane se répercute directement sur le montant de la TPS à payer à l’importation. Évaluez à nouveau votre cautionnement en douane afin de maintenir vos privilèges.
Mesures de réajustement stratégique pour l’adaptation à long terme de l’entreprise
Désormais, les entreprises n’ont d’autre choix que d’intégrer des mesures de réajustement à moyen et à long terme et certaines n’hésitent pas à revoir de fond en comble leurs modèles d’affaires transfrontalières :
- La conclusion d’un contrat de sous-traitance ou de fabrication avec une entreprise américaine permet aux entreprises canadiennes de conserver un accès au marché lorsque les matières premières proviennent des États-Unis et que les inventaires des produits finis sont conservés aux États-Unis. Ce contexte est une occasion pour les entreprises canadiennes d’agir comme entreprise manufacturière sous-traitante pour avoir accès au marché canadien et à d’autres marchés étrangers qui ont élevé des barrières tarifaires pour les produits en provenance des États-Unis.
- L’arbitrage des accords de libre-échange est en croissance. Le Canada a conclu plus de 60 ententes commerciales et est un carrefour stratégique pour la transformation à faibles droits tarifaires et les activités de réexportation.
- La mise en place de coentreprises avec des sociétés américaines.
- L’acquisition de sociétés américaines pour avoir une présence sur le marché américain et intégrer les chaînes d’approvisionnement aux États-Unis.
- La relocalisation des activités aux États-Unis.
Force majeure : un outil de protection limité
Vous comptez utiliser la clause de force majeure pour échapper aux pressions inflationnistes découlant des droits de douane? Réfléchissez bien! Les tribunaux canadiens interprètent ces clauses de manière stricte, et l’augmentation des coûts est rarement prise en compte.
La renégociation ouverte est une meilleure approche. Il est vivement recommandé aux entreprises de privilégier la transparence, tout en engageant, de manière proactive, des renégociations pour une meilleure coordination, dès le départ, avec les fournisseurs et les clients. Si nécessaire, soyez prêts à rajuster les paramètres commerciaux – prix, conditions de livraison, approvisionnement – et documentez rigoureusement le cadre décisionnel ayant motivé ces réajustements. Les frais doivent être évalués pour déterminer s’ils entraînent une valeur susceptible de faire l’objet de droits de douane.
Perspectives internationales et diplomatiques
Ces stratégies nationales s’inscrivent dans le sillage de tendances géopolitiques mondiales plus vastes. Les quatre raisons principales invoquées par les États-Unis pour justifier leurs récentes politiques tarifaires sont les suivantes :
- La lutte contre la crise des opioïdes (droits de douane imposés en vertu de l’IEEPA en lien avec le fentanyl)
- Le rapatriement des activités de production
- Le rétablissement de la balance commerciale
- La protection des secteurs à l’échelle nationale (article 232 sur les droits de douane)
Si certaines de ces raisons sont symboliques, d’autres sont imposées en réaction à une situation. Toutefois, la plupart découlent d’enjeux politiques forts.
Par ailleurs, entre les droits de rétorsion imposés par la Chine et l’Union européenne et les données récentes de l’OMC, une chose est claire : le protectionnisme gagne du terrain dans le monde. Les échanges commerciaux du Canada demeurent robustes, mais la stabilité n’est plus une certitude pour les entreprises.
Prochaines étapes pour les chefs d’entreprise
Les hausses des tarifs douaniers à répétition ont miné la confiance à l’égard des États-Unis en tant que partenaire commercial fiable sur l’échiquier international. Ceci pourrait avoir pour effet d’accélérer le rapprochement de la production, la diversification des marchés et la dissociation stratégique des entreprises canadiennes.
Dans ce contexte, nous recommandons aux chefs d’entreprises canadiennes la mise en œuvre des dix actions suivantes :
- Vérification des certifications en vertu de l’ACEUM et sensibilisation des fournisseurs.
- Cartographie des chaînes d’approvisionnement avec une visibilité claire sur l’origine des biens.
- Participation aux programmes de remise et de remboursement des droits de douane, si admissible.
- Décisions anticipées en matière de classement tarifaire et d’évaluation.
- Constitution d’une équipe stratégique de conformité douanière, réunissant les services des affaires juridiques, de la fiscalité et des opérations.
- Mise à jour des accords interentreprises et des modèles d’établissement des prix.
- Augmentation des cautionnements en douane en prévision des hausses des droits de douane.
- Examen de la structure du capital et risques fiscaux des sociétés affiliées.
- Surveillance attentive des changements apportés à la réglementation aux États-Unis et des mesures commerciales
- Engagement auprès des associations sectorielles pour participer au dialogue visant à influencer les politiques.
Conclusion : privilégier une approche stratégique plutôt qu’une réaction au choc
Les droits de douane ne sont pas des perturbations passagères; ils représentent un risque structurel du commerce international. Les entreprises canadiennes qui investiront dans la clarté sur le plan juridique, dans la transparence de leurs chaînes d’approvisionnement et dans la planification fiscale stratégique seront outillées pour traverser cette période de turbulences commerciales et en ressortiront plus fortes.
Dans le contexte actuel, les entreprises qui exportent des biens vers les États-Unis ont tout intérêt à revoir la structure, la conformité et la résilience de leurs opérations.
Pour obtenir des conseils juridiques ou stratégiques propres à votre secteur d’activité, consultez un membre de l’équipe Commerce mondial et douanes pour transformer les incertitudes actuelles en leviers de croissance, sans jamais compromettre la conformité, même dans le contexte actuel en perpétuelle transformation.